
Comment calculer son empreinte carbone ?
L'empreinte carbone est un outil permettant d'évaluer le niveau d'émissions de gaz à effet de serre (GES) générées. Mais que faut-il savoir à son sujet ?
ESG / RSE
Secteurs d'activité
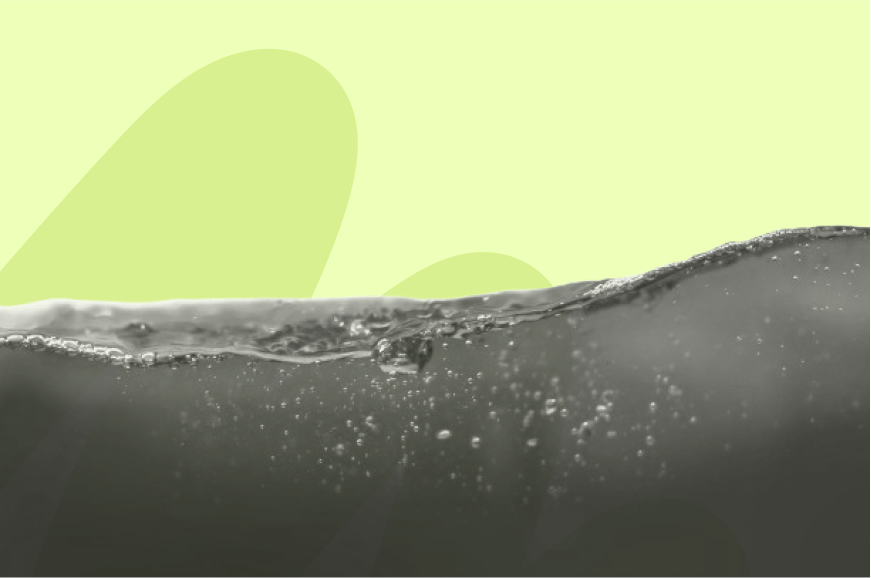
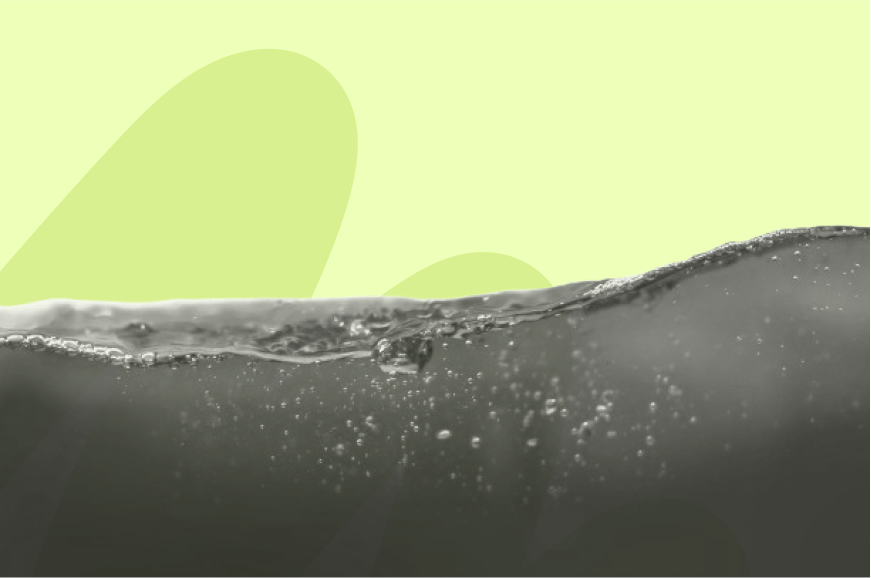
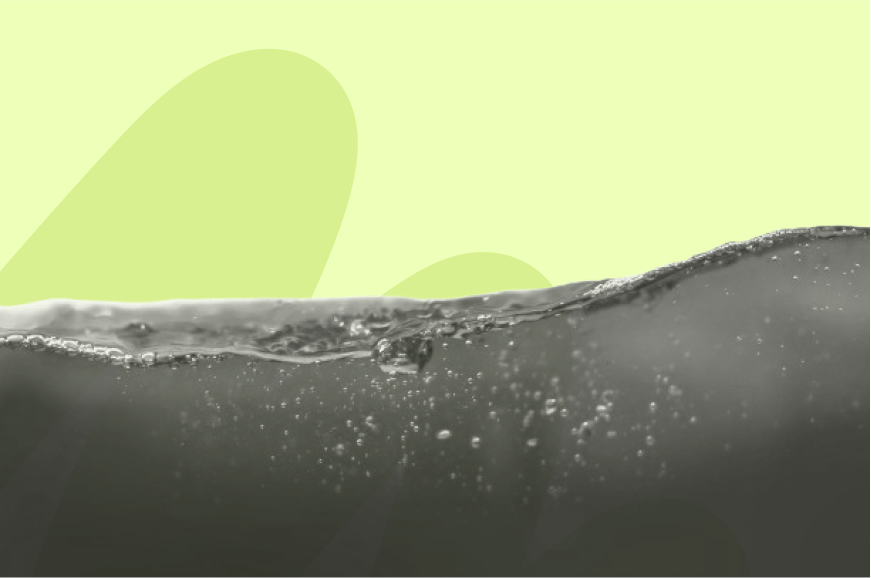
Emmanuel Macron a dévoilé le « plan eau » le 30 mars 2023 pendant son voyage à Savines-le-Lac. Ce projet, dénommé « plan eau », s'aligne sur une démarche de planification écologique, et est composé d’une série de mesures relatives à la gestion de l’eau. Les objectifs fixés concernent l'élaboration d'un système plus économe et résilient, favorisant une répartition équitable de la ressource.
À terme, il s’agit d’adapter la politique de l’eau française aux enjeux du changement climatique (notamment aux sécheresses). Deux grands objectifs ont été définis en ce sens :
Pour y parvenir, l’État et les collectivités investiront chaque année près de 500 millions d’euros supplémentaires.
Le « plan eau » complète la politique française de l’eau, structurée par quatre grandes lois. La loi de 1964 organise le territoire selon les bassins hydrographiques et instaure le principe « pollueur-payeur ». La loi de 1992 reconnaît l’eau comme patrimoine commun et généralise les systèmes de collecte et d’épuration. La loi de 2004 transpose la directive cadre européenne, visant la préservation et la restauration des milieux aquatiques et la réduction de la pollution. Enfin, la loi de 2006 (LEMA) fixe l’objectif d’un bon état écologique des eaux et met en place des outils pour économiser l’eau, partager les ressources, lutter contre les pollutions et restaurer les milieux aquatiques. Il est néanmoins constaté que ces réglementations se concentrent sur la qualité de l’eau et la réduction de sa pollution, sans encadrer la quantité disponible.
Le Plan Eau vient combler cette lacune, offrant ainsi un cadre législatif complet et cohérent pour la gestion de la ressource.
Les épisodes de sécheresse se sont intensifiés en France depuis 2022, entraînant des pénuries d’eau potable et une lente recharge des nappes phréatiques. La sécheresse historique de l’été 2023 a aggravé cette situation dans plusieurs régions, et le problème est resté préoccupant en 2024, les niveaux des nappes restant très en dessous du seuil requis.
C’est dans ce contexte marqué par la diminution progressive des précipitations et la récurrence des sécheresses que le plan eau a été mis en place pour mieux gérer la ressource.
Il est à noter que ce plan s'intègre aussi dans la continuité des actions suivantes :
Le « plan eau », qui est jugé prioritaire dans la planification écologique, se structure autour de cinq axes. Au total, ces axes comprennent 53 mesures visant à améliorer la gestion de l'eau, avec pour objectifs principaux :
| Axe | Mesures clés |
|---|---|
|
Sobriété des usages
|
- Mesure 10 : objectifs concrets et chiffrés pour diminuer la quantité d'eau prélevée dans chaque territoire d'ici 2027. Chaque région devra se fixer un pourcentage de réduction et s'y tenir. - Dans la Manche, un plan spécifique de gestion des ressources en eau est en cours d'élaboration. |
|
Optimiser la disponibilité
|
- Mesure 14 : sécurisation des réseaux, suivi via observatoire en ligne. - Mesures 16 et 17 : création d’un guichet unique pour encourager le recyclage des eaux usées et un observatoire pour suivre ces pratiques. - Dans la Manche, certaines collectivités devront obligatoirement utiliser le système SISPEA pour gérer leurs services d'eau. |
|
Préserver la qualité et restaurer les écosystèmes
|
- Mesure 23 : impose la création de plans de gestion sanitaire (PGSSE) pour protéger les sources d'eau potable (captages) contre les pollutions et contaminations. - Mesure 28 : mesures correctives en cas de dépassement des pesticides. |
|
Gouvernance et moyens
|
- Mesure 33 : création d’instances de dialogue entre tous les acteurs par sous-bassin hydrographique pour élaborer des projets de territoire adaptés aux enjeux locaux. |
|
Gestion des crises
|
- Mesure 50 : développement de l'outil numérique VigiEau qui permet à chaque citoyen de connaître instantanément les restrictions d'eau en vigueur dans sa commune. - Mesure 51 : mise à jour du guide national des restrictions d'eau. - Plan ORSEC RETAP : prépare la gestion des crises plus larges comme les tempêtes (exemple : tempête Ciaran). Source : Les services de l'État dans la Manche |
Pourtant l’eau fait l’objet de plusieurs enjeux et au-delà de répondre à nos besoins vitaux, ces multiples usages doivent être régulés pour garantir l’accès à l’eau potable à tous les citoyens car :
En France, cette ressource vitale est sous pression croissante pour plusieurs raisons fondamentales :
| Cause | Phénomène observé | Conséquence |
|---|---|---|
|
Changement climatique
|
Perturbe le cycle de l’eau | Intensification de l'évaporation : +7% par degré de réchauffement d’après Réseau Action Climat (2017). Cela entraîne un déplacement des précipitations, une aggravation des périodes sèches et une amplification des inondations dans certaines zones. |
|
Surexploitation des aquifères
|
Empêche le renouvellement naturel des nappes phréatiques | C'est comme vider un compte en banque plus rapidement qu'on ne l'alimente : risque de pénurie d’eau potable, assèchement des rivières et des zones humides, dégradation des écosystèmes… |
|
Démographie exponentielle
|
Augmentation des usages et besoin en eau | En moyenne, un Français consomme 150 litres d’eau par jour d’après Eau France (2024). Ce chiffre, multiplié par des millions d’habitants, exerce une pression importante sur les ressources disponibles. |
|
Agriculture
|
Conflit d’usage, pollution et pesticides | L’agriculture implique une irrigation importante (surtout pour le maïs), et l’utilisation de nitrates et pesticides qui rendent une part croissante de l'eau inutilisable. Cela génère des conflits d'usage : entre besoins agricoles (irrigation, bétail), besoins humains (eau potable, domestique) et impératifs écologiques. |
Le « plan eau » répond à un constat alarmant : entre 1990 et 2018, la ressource en eau renouvelable a diminué de 14 % en France métropolitaine, selon le Commissariat général au développement durable (2025).
Cette baisse résulte d’un cumul de facteurs : modification des régimes de précipitations liée au changement climatique, surexploitation de certaines nappes et rivières, et pression croissante des usages agricoles, industriels et domestiques.
Les 53 mesures concrètes, visant 10 % d’eau prélevée en moins d’ici 2030, traduisent la nécessité de préserver la ressource et d’anticiper les tensions hydriques à venir, même si l’ambition reste modeste face aux projections climatiques et aux épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents.
C'est un plan nécessaire mais qui gagnerait à être plus radical face à l'urgence climatique.
L'eau représente un enjeu majeur pour le fonctionnement d'une entreprise, tant sur le plan opérationnel que environnemental.
Greenly accompagne les entreprises dans la transformation de la gestion de l’eau en avantage stratégique, en analysant l’impact hydrique de leurs activités quotidiennes – consommation directe, processus industriels et chaîne d’approvisionnement. Pour répondre à ces enjeux, deux axes d’action sont privilégiés :
L’eau représente-t-elle un enjeu stratégique pour votre entreprise ? Pour découvrir comment Greenly peut vous aider à le maîtriser, réservez une démo avec l’un de nos experts climat !