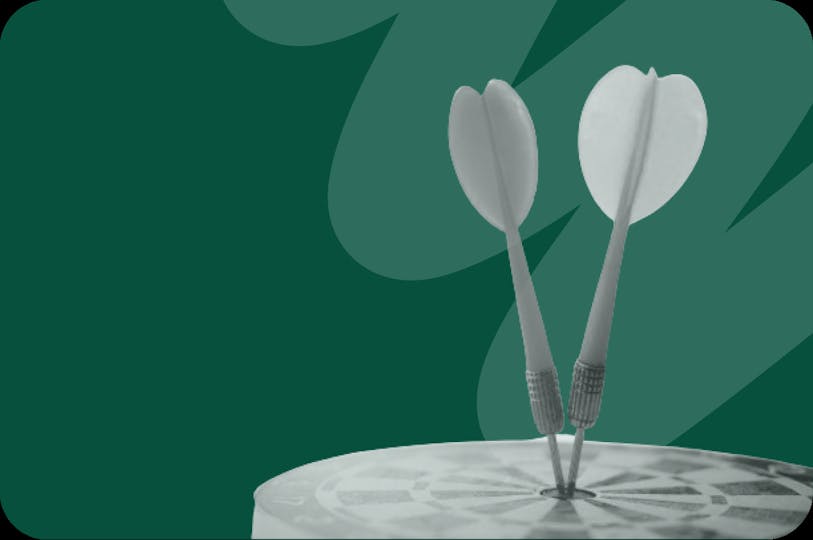
SBTi (Science-based Targets Initiative) : ce qu’il faut savoir
Qu'est-ce que la SBTi ? Pourquoi et comment devriez-vous l'appliquer en entreprise ? Greenly vous dit tous de la Science-based Targets Initiative.
ESG / RSE
Secteurs d'activité



Un compte à rebours inquiétant est enclenché : plus l’économie s’expand, plus sa croissance s’accélère…
Adam Smith, célèbre économiste, a parlé de la croissance économique en se référant à une vision du monde plus holistique, englobant la production industrielle et le commerce international (source : Mister Prépa, 2024).
Selon Adam Smith, la croissance repose sur l'idée que la richesse des nations provient de la division du travail (décomposition en tâche spécifique), ce qui permet une production plus efficace. Toujours selon cet économiste, la croissance économique est stimulée par l'accumulation de capital et l'augmentation de la productivité, notamment grâce à l'investissement dans les infrastructures et la spécialisation. Il défend aussi l'idée que l'économie de marché, guidée par la célèbre « main invisible », stimule l'innovation et la prospérité en offrant aux individus la possibilité de suivre leur propre intérêt, ce qui est profitable pour la société dans son ensemble.
Il y a près d’un siècle, la révolution de la comptabilité nationale a vu émerger ce qui constitue désormais la pierre angulaire de la vie économique : le Produit Intérieur Brut (PIB), pensé par Simon Kuznets et conçu pour quantifier cette insaisissable notion de croissance
Toutefois, aux yeux du PIB tout ce qui ne donne pas lieu à une transaction financière n’a pas de valeur – et qui pourtant participe autant à la vie économique, social et environnemental de la société (s’occuper d’un jardin partagé, être bénévole dans une association de lutte contre la pauvreté, s’occuper de ses aînés…). De plus, le PIB fait abstraction de la nature.
À l'instar de plusieurs autres services environnementaux qui sont exclus des procédures de comptabilisation, bien que leur valeur en termes monétaires soit inestimable, la pollinisation est également absente des mécanismes de comptabilité économique malgré son importance incommensurable.
Cet oubli survient alors même que nos systèmes de production agricole dépendent intrinsèquement de ces fonctions écologiques essentielles — tandis que, paradoxalement, les pratiques agricoles intensives (usage de pesticides, destruction des habitats naturels, etc.) compromettent leur maintien.
Toutefois, l’imaginaire d’une croissance infinie, tout comme sa mesure à travers le PIB, soulève aujourd’hui de nombreuses limites et controverses.
L’économie et l’idéal de croissance est devenue le dogme de nos sociétés contemporaines, tout doit être rentable, de nos jours, à la résolution des problèmes économiques, sociaux (accueillir des réfugiés est-il rentable ?) ou environnementaux (lutter contre le réchauffement climatique est-il rentable ?), etc.
La croissance incarne un imaginaire économique dominant, valorisant avant tout les activités marchandes quantifiables, et occultant une grande partie du travail invisible — soins, bénévolat, travail non déclaré, etc. — tantôt essentiels au bon fonctionnement de la société, tantôt largement développés.
Cette vision étroite néglige également la valeur des services écosystémiques et du bien-être social qui échappent aux métriques traditionnelles.
Posez-vous la question : est-il possible de maximiser la croissance sans détruire du capital naturel ? En réalité, la croissance perpétuelle sur une planète aux ressources finies constitue un modèle de développement qui révèle aujourd'hui ses limites fondamentales face aux défis environnementaux et sociaux.
La décroissance s'oppose à la croissance économique typique du capitalisme, axée sur l'expansion continue de l'économie et l'accumulation incessante de richesse comme but premier.
La décroissance propose donc un découplage entre bien-être et consommation matérielle, en orientant la production vers les besoins réels plutôt que la stimulation artificielle de la demande (obsolescence programmée, spécialisation, etc.).
Bien que les idées centrales de l'économie décroissante varient d'un penseur à l'autre, on peut citer les principales ci-dessous :
Ces objectifs ont pour but de faire évoluer l'économie actuelle vers une économie de « post-croissance » afin de respecter les limites planétaires, également connues sous le nom de « biocapacité » de la terre. Cela signifie la capacité de la terre à renouveler les ressources naturelles utilisées par les Hommes et à gérer les déchets et la pollution qu'ils génèrent.
Les premiers penseurs de la décroissance sont l’économiste Nicholas Georgescu-Roegen et le philosophe Ivan Illich.
En France, Serge Latouche a été l’un des premiers à théoriser la décroissance, tandis que Timothée Parrique, chercheur en économie écologique, en est aujourd’hui l’un des principaux porte-voix.
Tout d’abord, la notion de décroissance émerge progressivement dans les années 1970, à la suite du célèbre rapport Meadows, souvent associé à la théorie de l’effondrement. Ce rapport alertait, à travers des modélisations scientifiques, sur le dépassement potentiel des limites biophysiques de la planète. Les premiers penseurs de la décroissance sont l’économiste Nicholas Georgescu-Roegen, notamment avec son ouvrage The Entropy Law and the Economic Process (1971), et le philosophe Ivan Illich, dont les critiques de la société industrielle ont profondément influencé ce courant (source : Alternatives Économiques).
Malgré les avertissements répétés des scientifiques, notamment dans les rapports du GIEC, les progrès réalisés depuis sont restés marginaux : les rares innovations technologiques ont souvent été éloignées de l'urgence écologique pour répondre à d’autres besoins, sans enrayer les effets néfastes de la croissance.
C’est au début des années 2000 que le terme « décroissance » prend véritablement forme en France, notamment avec la publication de l’article « Décroissance soutenable et conviviale » dans le magazine Silence (2002).
L’économiste Serge Latouche s’impose alors comme l’un des penseurs majeurs de ce courant. Il propose une rupture radicale avec le modèle économique dominant, et introduit l’idée d’une « désintoxication mentale » face à l’idéologie de la croissance, illustrée par sa célèbre formule :
En 2007, la décroissance entre dans le champ académique avec une première revue scientifique : Is Degrowth Compatible with a Market Economy? (Fotopoulos, 2007). Depuis, le concept s’est institutionnalisé : colloques, publications et mouvements militants se sont multipliés à travers l’Europe...
Parmi les voix contemporaines de la décroissance, le chercheur français Timothée Parrique, docteur en économie écologique à l’université de Lund (Suède), fait figure de référence.
Il est aujourd'hui chercheur en économie écologique à l'université de Lund en Suède. Il a contribué à légitimer académiquement la décroissance en la distinguant clairement de la récession économique involontaire, notamment par ses prises de parole publiques et sa présence sur les réseaux sociaux où il est suivi par presque 40 000 personnes (source : Instagram, 2025).
Son apport majeur réside dans l'élaboration d'un cadre conceptuel structuré où la décroissance devient un processus planifié de réduction contrôlée de la production et consommation matérielles, tout en améliorant le bien-être social : c’est la post-croissance – qu’il définit comme :
À travers ses publications et son ouvrage "Ralentir ou périr", il défend une approche interdisciplinaire qui mêle limites planétaires et justice sociale, dépassant ainsi les critiques réductionnistes associant décroissance et austérité.
Le livre "Ralentir ou périr", au-delà de retracer le cheminement de pensée de la décroissance, explique le projet de la post-croissance de manière simple et accessible, tout en analysant les limites du modèle actuel de façon très clairvoyante.
D'après le livre "Ralentir ou périr" de Timothée Parrique, le modèle de croissance actuel présente de nombreuses contraintes telles que :
C'est aussi une critique de tous les a priori liés à la croissance, puisque Timothée Parrique explique que même si la décroissance conduit à une diminution de points de PIB et de la production, cela ne mène pas nécessairement à une récession mais plutôt à une « économie stationnaire post-croissance au PIB stable » (source : Timothée Parrique, Ralentir ou périr, Seuil, p.220).
En effet, de nombreux produits aux externalités négatives ne seraient plus fabriqués (par exemple les SUV, les vêtements de fast-fashion, etc.), le temps de travail serait réduit et les efforts de production seraient redirigés vers des services essentiels (comme les services publics).
De plus, le projet de décroissance est ici étroitement lié à la justice sociale, car celle-ci ne s'opère pas dans les pays qui ont besoin de croissance, mais dans les pays riches qui produisent beaucoup au détriment des autres populations et de la nature. L'auteur démonte méthodiquement l'idée selon laquelle nous pourrions découpler la croissance économique de son impact environnemental.
Selon Timothée Parrique, la décroissance doit trouver un équilibre entre (source : Timothée Parrique, Ralentir ou périr, Seuil, p.229) :
Ralentir ou périr propose donc une nouvelle façon de penser la décroissance, en mettant l'accent sur la planification et en répondant aux critiques à son sujet dans son dernier chapitre de façon claire. Le livre aborde aussi la notion de justice sociale, et l'auteur connecte la théorie économique avec les mouvements sociaux actuels. Il traite également de la biodiversité – un sujet très souvent oublié dans la sphère économique. Contrairement à certaines perceptions, Timothée Parrique présente la décroissance non comme une privation, mais comme une opportunité de redéfinir la prospérité et le bien-être social en dehors du cadre productiviste.
Pour juger de la pertinence d'un système dans le cadre d'une transition écologique et sociale, on peut se référer à trois critères essentiels :
La soutenabilité : c’est la charge écologique, autrement dit la capacité d’un système à fonctionner sans dépasser les limites biophysiques de la planète.
La convivialité : c’est le bien-être des parties prenantes, c’est-à-dire la capacité d’un système à favoriser des relations humaines justes, inclusives et fondées sur le partage.
La productivité : ou plutôt l'efficience productive, pour re-déterminer avant tout pour pourquoi on produit, pour qui, à quel coût social et écologique, etc.).
La philosophie de la décroissance s'articule autour d'une planification raisonnée des ressources qui rejette la croissance comme finalité économique. Elle prône plusieurs principes :
L'engagement individuel dans la "simplicité volontaire", comme le soulignait la revue Silence (2002), constitue un premier niveau d'action. Cependant, Timothée Parrique affirme que la décroissance doit s'opérer avant tout dans un souci de justice sociale : elle ne doit pas être imposée à ceux dont le revenu est déjà faible et l'accès aux ressources compromis, mais plutôt aux plus riches.
L'objectif serait de tendre vers ce qu'on appelle donc la "post-croissance" : une économie stationnaire en harmonie avec le vivant, où les décisions économiques sont prises collectivement et où les richesses sont équitablement partagées afin de pouvoir prospérer sans croissance.
« La décroissance, c'est la fin de notre modèle social, c'est la pauvreté de masse. Jamais je ne l'accepterai », fustigeait Gabriel Attal à l'Assemblée nationale (source : Le Monde, 2021). Cette opposition radicale à la décroissance appelle pourtant une réflexion plus nuancée : de quelle pauvreté parle-t-on, et pour qui ?
Pour répondre à ses détracteurs, Timothée Parrique soutient pourtant qu’une économie libérée de la logique du profit et des rentes permettrait un retour à des prix justes, stables et encadrés, fixés en cohérence avec les coûts réels de production. C'est une économie de gratuités partagées où le partage prime sur la possession.