ESG / RSE
Secteurs d'activité
Tout savoir sur l'Affaire du Siècle
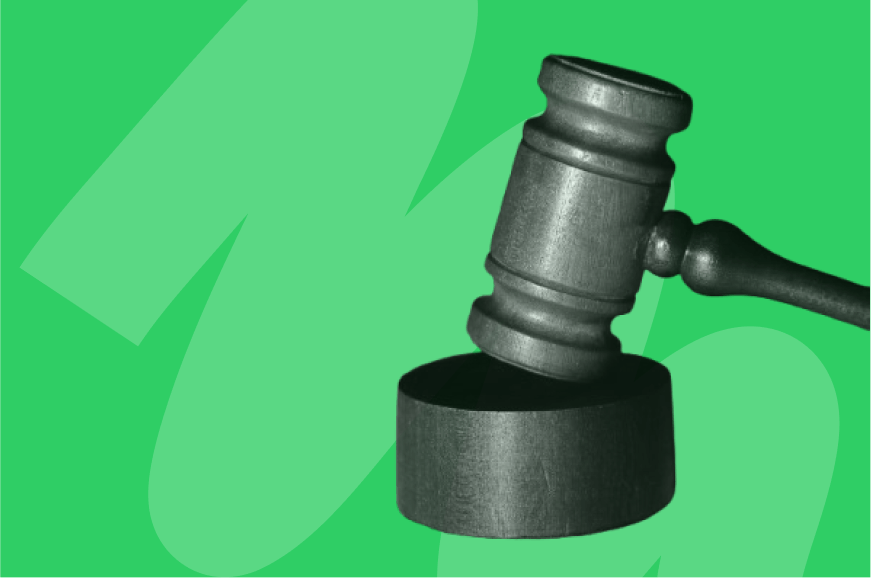
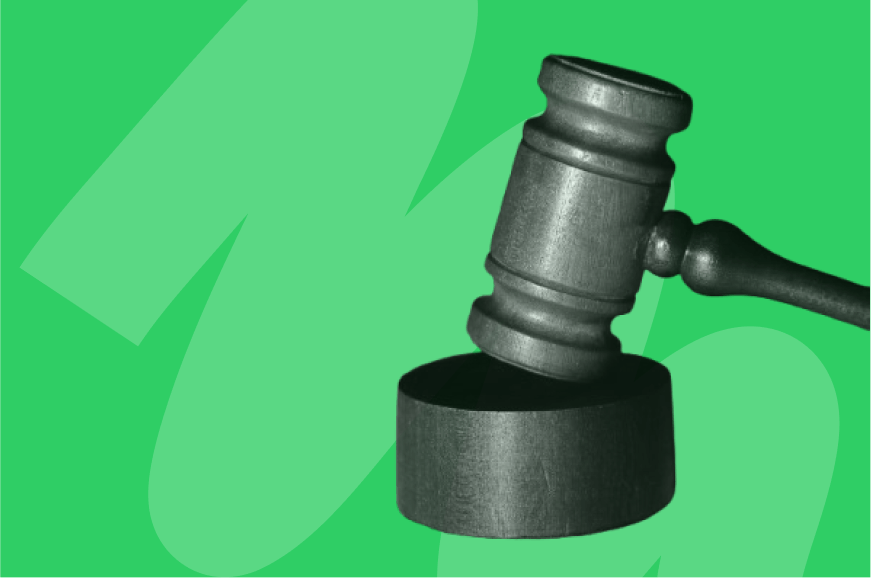
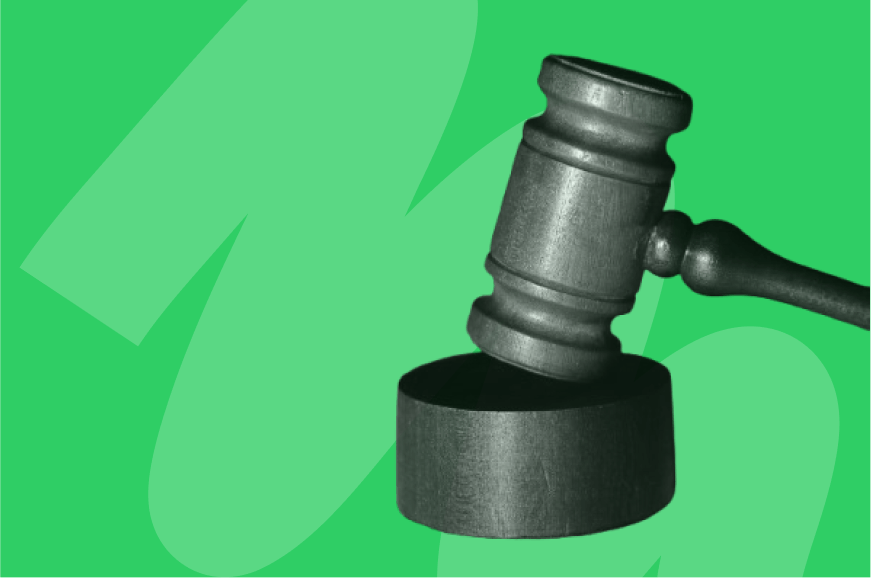
C’est ainsi qu’une lettre, envoyée le 8 février au Premier ministre par le collectif L’Affaire du Siècle, a marqué le point de départ d’une bataille juridique unique. Derrière ces mots simples, se cache l’une des affaires judiciaires les plus marquantes de l’histoire du climat en France.
Qu’est-ce que L'Affaire du Siècle ?
L’Affaire du Siècle : un cri d’alerte face au réchauffement climatique
L’Affaire du Siècle est un recours en justice en France, initié par le collectif éponyme en 2018 – et fondé par quatre associations – avec un objectif précis :
NB : Popularisé par une vidéo publiée en décembre 2018 et portée par 32 célébrités françaises (Cyril Dion, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Élie Semoun, etc.), le cas de L’Affaire du Siècle est rapidement devenue virale. En moins de 48 heures, la pétition de soutien a recueilli plus d’un million de signatures, avant de dépasser la barre des deux millions en moins de trois semaines. En France, lorsqu'une pétition parvient à rassembler plus de dizaines de milliers de signatures, elle est susceptible d'être soumise à une discussion au sein de l'Assemblée nationale.
Justice climatique : pourquoi exiger des comptes à l’État ?
Selon Cairn, l'effet du changement climatique sur les individus est de plus en plus palpable, particulièrement à travers les canicules répétées qui ont servi d'électrochoc et de catalyseur. Elle a rendu l'opinion publique davantage réceptive à l'idée que les origines du réchauffement climatique peuvent engendrer des conséquences néfastes (source : Cairn, 2022).
Hormis les canicules, les événements météorologiques extrêmes se multiplient (sécheresses, inondations, etc.). Or, en tant que garant du bien commun et signataire d’engagements internationaux, l’État a une responsabilité morale et juridique dans la protection des citoyens face à ces risques.
La fréquence et l’intensité des catastrophes climatiques s’aggravent dramatiquement, entraînant des pertes humaines et matérielles qui auraient pu être atténuées par une politique d'atténuation et d'adaptation plus ambitieuse et une utilisation optimisée des budgets alloués.
En ce qui concerne ses engagements climatiques, la France est effectivement sur la bonne voie, mais elle progresse trop lentement : depuis 2015, les émissions de gaz à effet de serre en France ont recommencé à augmenter. Et le plan climat adopté au début du mandat, destiné à réduire de nouveau les émissions en 2018, accusait un retard significatif par rapport à ses objectifs. Par ailleurs, si l'on considère les émissions liées à la consommation de produits importés par les Français, l'empreinte carbone de la France se situe en réalité au même niveau qu'en 1995 (source : Le Monde, 2019).
Le collectif « L'Affaire du Siècle » s'efforce donc de faire respecter l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l'État.
En mai 2019, L'Affaire du Siècle a réalisé une vaste enquête auprès des personnes ayant signé la pétition dans le but de comprendre leurs motivations pour soutenir cette cause. Cela traduit le désir de tenir l'État français responsable, car pour 98 % des participants, « les petits pas du gouvernement sont insuffisants par rapport à l’urgence » (source : L’Affaire du Siècle, 2019).
Poursuivre son propre gouvernement est un levier juridique accessible et concret pour les citoyens, alors que les émissions d'autres pays, bien que potentiellement plus importantes, relèvent d'autres juridictions.
Quels sont les acteurs impliqués dans L'Affaire du Siècle ?
En 2018, quatre organisations de protection de l’environnement ont été à l’origine du collectif L’Affaire du Siècle (source : L’Affaire du Siècle) :
- Notre Affaire à Tous, qui agit pour la justice climatique en utilisant le droit comme outil de mobilisation ;
- la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), qui œuvre pour le respect de la Nature tout en garantissant le bien-être de l’Homme ;
- Greenpeace France, qui s’emploie à protéger l’environnement, la biodiversité, le climat et promeut la paix et la non-violence ;
- Oxfam France, qui lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, notamment en dénonçant l’impact du changement climatique sur les populations les plus vulnérables.
NB : Ces associations sont co-requérantes – c’est-à-dire qu’une fois devant le juge, elles assument la responsabilité juridique et financière de L’Affaire du Siècle porté au nom de l’intérêt général. Elles sont accompagnées et représentées par une équipe d’avocats et de juristes.
Deux années plus tard, en juin 2020, trois autres organisations sont devenues intervenantes volontaires :
- la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, qui est le seul réseau professionnel agricole français spécialisé en agriculture biologique ;
- la Fondation Abbé Pierre, engagée dans la lutte contre le mal-logement, et souligne les liens entre précarité énergétique et justice climatique ;
- et France Nature Environnement, fédération regroupant plus de 3 500 associations locales, elle œuvre pour la protection de la nature et du climat en France.
En octobre 2020, elles sont rejointes par l’organisation Anper-Tos – l’Association Nationale de Protection des Eaux et Rivières : Truite-Ombre-Saumon – qui lutte pour la préservation des milieux aquatiques et la protection des espèces piscicoles.
Sur quoi reposait la plaidoirie du collectif ?
Pour construire sa plaidoirie, le collectif L'Affaire du Siècle s’appuyait sur plusieurs arguments clés. D'abord, ils démontraient la carence fautive de l'État français dans ses obligations climatiques, notamment son incapacité à respecter ses propres engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.
Pour ce faire, le collectif reposait sa plaidoirie sur des droits fondamentaux, tels que le droit international, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ou l’important Accord de Paris – établissant ainsi une base juridique solide.
Le collectif prouvait ainsi le lien direct entre cette inaction et les préjudices écologiques concrets.
De plus, l’accord fournissait un cadre contraignant que la France avait ratifié, s'engageant à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C – avec des objectifs précis en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Motrice sur le sujet et hôte de la COP21, la France a joué un rôle clé dans l’adoption de l’Accord de Paris, ce qui lui confère une responsabilité particulière dans sa mise en œuvre et le respect de ses engagements. Enfin, ils invoquaient le principe du "préjudice écologique" reconnu dans le Code civil depuis 2016, permettant de qualifier juridiquement les dommages causés à l'environnement par cette inaction climatique.
Quelles sont les étapes de L'Affaire du Siècle ?
Quelle est la date de lancement de L'Affaire du Siècle ?
Tout débute le 17 décembre 2018, les organisations à l’origine de L’Affaire du Siècle font parvenir une lettre de 41 pages intitulée « demande préalable indemnitaire » au Premier ministre et à 12 membres du gouvernement.
Cette lettre démontre à travers plusieurs arguments l’inaction de l’État dans la lutte contre le réchauffement climatique et exige la réparation des préjudices engendrés. Cette première étape marque le lancement d’une procédure au tribunal.
Une procédure que le gouvernement rejettera le 15 février 2019 : un refus qui scellera l’ouverture de la bataille judiciaire dès le 14 mars suivant.
L'Affaire du Siècle : Quand la procédure judiciaire a-t-elle débuté ?
L’instruction débute le 20 mai 2019 avec le dépôt du « mémoire complémentaire » des associations co-requérantes. Il s'agit d'un document où les associations détaillent leurs arguments et renforcent leur position initiale. Le gouvernement rétorque le 23 juin 2020 avec son « mémoire de défense », avant d’obtenir une réponse du collectif le 6 septembre 2020 – avec le « mémoire de réplique ».
Cette bataille argumentaire prend fin le 9 octobre 2020, lorsque le tribunal administratif décide de clore l’instruction.
L'audience débute alors le 14 janvier 2021 et se conclut trois semaines plus tard par une victoire sans précédent des associations. Le tribunal administratif de Paris reconnaît la responsabilité de l'État sur trois points :
- l’illégalité de l’inaction climatique de l’État, puisque les budgets carbone n’ont pas été respectés pour la période 2015-2018, ce qui est perçu comme une carence fautive.
- la responsabilité de l’État envers les émissions excessives de gaz à effet de serre ;
- le préjudice écologique causé, c’est-à-dire que la France n’a pas respecté ses engagements climatiques et est ainsi à l’origine de multiples dommages environnementaux plus ou moins graves.
L’État a-t-il été condamné pour inaction climatique ?
Le Tribunal administratif de Paris a, pour la première fois, ordonné à l’État de réparer les conséquences de son inaction face au changement climatique. Il a ainsi décidé que l'État devait prendre « toutes les mesures utiles » d’ici le 31 décembre 2022 au plus tard, pour compenser le dépassement des plafonds des budgets carbone entre 2015 et 2018 (source : Tribunal administratif de Paris, 2021).
Le tribunal a donc ordonné au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer le préjudice écologique lié aux émissions de gaz à effet de serre non compensées par le premier budget carbone.
Toutefois, bien que le tribunal ait ordonné au gouvernement de prendre des mesures pour réparer le préjudice écologique causé par les émissions excédentaires de gaz à effet de serre, il ne lui impose pas de manière détaillée quelles actions spécifiques doivent être prises…
Où en est L'Affaire du Siècle ?
Le 20 décembre 2022, les associations demandeuses ont adressé une lettre formelle au Gouvernement en estimant que l'État n'a pas pris des mesures adéquates depuis la décision du 14 octobre 2021.
Le 14 juin 2023, les trois organisations requérantes ont déposé un nouveau mémoire au tribunal administratif de Paris – afin de prouver que l'État n'avait pas mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour réparer le préjudice écologique.
Deux nouveaux rapports ont été publiés en novembre de la même année, dans le but de prouver que la diminution des émissions de gaz à effet de serre soulignée par le gouvernement est liée à des éléments conjoncturels plutôt qu'à des facteurs structurels.
En d'autres termes, ces baisses seraient majoritairement attribuables à des circonstances temporaires, et non à des modifications significatives liées aux politiques. Toutefois, en décembre de cette même année, le Tribunal Administratif de Paris rend une décision défavorable aux associations, estimant que l'État a rempli ses obligations issues de la condamnation de 2021 et les associations n’ont pas pu faire appel...
Dans un rebondissement significatif pour la justice climatique française, le Conseil d'État vient d'octroyer aux organisations de l'Affaire du Siècle le droit de faire appel d'une décision qui semblait avoir clos le chapitre judiciaire de cette affaire emblématique.
Cette décision intervient après un parcours semé d'embûches procédurales pour Notre Affaire à Tous, Greenpeace France et Oxfam France qui, depuis la condamnation historique de l'État français en 2021, s'efforcent d'obtenir une réparation effective du préjudice écologique (source : L’Affaire du Siècle, 2024).
L’Affaire du Siècle a-t-elle son équivalent dans le monde ?
L'Affaire du Siècle a déclenché un mouvement de contestation internationale, résultat d'une prise de conscience croissante face à l'urgence climatique.
En 2021, l’UNEP - UN Environment Programme, recensait plus de 1 500 litiges climatiques à travers le monde initiés par des individus et des organisations (source : UNEP, 2021). Il y a maintenant une abondance d'exemples d'actions similaire à cette affaire comme :
- quatre autorités belges (Région flamande, Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale, État fédéral) ont été poursuivies par 55 000 co-demandeurs dans le cadre de l'Affaire Climat – et ont été accusées de ne pas prendre suffisamment de mesures pour lutter contre le changement climatique ;
- les Pays-Bas ont été condamnés à revoir à la hausse leurs ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la suite du procès avec la Fondation Urgenda ;
- le gouvernement néerlandais à la suite de la décision de la Cour suprême des Pays-Bas a dû augmenter ses efforts pour respecter les objectifs climatiques.
En décembre 2018, la ville de Grande-Synthe – menacée par la montée des eaux — lance une procédure annexe à celle de l’Affaire du Siècle en déposant un recours climatique devant le Conseil d’État. Elle a contesté l'inaction de l'État face aux dangers liés à la montée des eaux. En 2021, le Conseil d'État a reconnu l'inaction de l'État mais n'a pas ordonné de mesures concrètes immédiates. En fait, le Conseil d'État a reconnu l'inaction du gouvernement face à la crise climatique mais a estimé que les résultats des réductions d'émissions étaient influencés par des facteurs externes comme la pandémie et la crise énergétique (source : Novethic, 2023).



